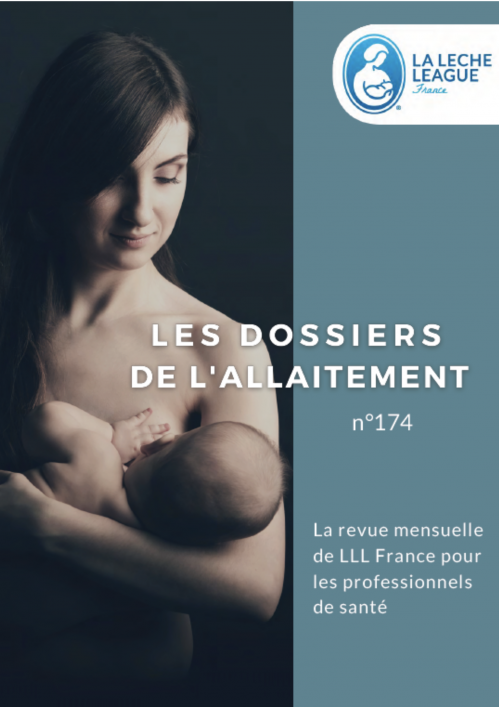Ostéoporose liée à la grossesse et à l’allaitement avec spondylodiscite à pyogènes
L’ostéoporose liée à la grossesse et à l’allaitement est une pathologie relativement rare qui se caractérise par la survenue d’une ostéoporose entre le 3e trimestre de la grossesse et 18 mois post-partum. Son étiologie reste mal connue, mais on suppose la combinaison d’une prédisposition génétique, de modifications hormonales induites par la grossesse et la lactation, et de modifications du métabolisme calcique pendant ces périodes pour couvrir les besoins du foetus et du nourrisson. Sa principale manifestation clinique est la survenue de fractures vertébrales de compression. La spondylite à pyogènes est une infection bactérienne touchant le corps des vertèbres, les disques intervertébraux et/ou les tissus environnants. Elle survient surtout au niveau lombaire. Les auteurs présentent le cas d’une femme qui a présenté une ostéoporose liée à la grossesse et à l’allaitement combinée à une spondylite à pyogènes.
Vasospasme du mamelon : cas clinique
Le syndrome de Raynaud se caractérise par des épisodes de vasospasme, qui constituent une réponse exagérée à une exposition au froid ou à un stress émotionnel. Typiquement, il se traduit par des modifications de couleur de la peau et une douleur mamelonnaire à type de brûlure. Le diagnostic se fonde sur la clinique et la constatation des modifications de couleur. Il touche habituellement les doigts des mains et des pieds, mais il peut survenir à d’autres endroits, comme au niveau des mamelons. En raison de la douleur qu’il induit, il pourra amener la mère à sevrer. Pourtant, il est possible de le traiter efficacement. Les auteurs présentent un cas de vasospasme du mamelon.
Soutien à l’allaitement chez une mère présentant un syndrome du tuyau rouillé
Le syndrome du tuyau rouillé est un problème survenant pendant la période de démarrage de l’allaitement. Il se caractérise par la couleur rose, rouge ou brune du colostrum, généralement au niveau des deux seins, en raison de la présence de sang, ce qui peut être une source importante d’inquiétude pour la mère et les soignants. On ignore sa prévalence. Ce phénomène est bénin, indolore, et il disparaît spontanément au bout de quelques jours. L’auteur rapporte un cas de syndrome du tuyau rouillé.
Hypogalactie primaire : 3 cas
La grande majorité des mères peuvent sécréter suffisamment de lait pour nourrir leur bébé. Toutefois, de nombreuses mères estiment ne pas avoir suffisamment de lait. Une production lactée insuffisante est généralement le résultat de pratiques inadéquates d’allaitement (hypogalactie secondaire), et parfois d’un problème chez le nourrisson. La production lactée dépend de 3 facteurs : une succion efficace du bébé, une capacité suffisante de sécrétion lactée par la glande mammaire, et un réflexe d’éjection efficace. Il arrive qu’une femme présente un problème qui induit une hypogalactie dite primaire : hypoplasie mammaire, chirurgie mammaire ayant induit une perte importante de tissu glandulaire, troubles hormonaux… C’est un problème rare, mais qu’il est nécessaire de dépister rapidement. Le risque d’hypogalactie est plus élevé lorsque la femme n’a constaté aucune augmentation de volume de ses seins pendant la grossesse. L’hypoplasie mammaire est diagnostiquée devant certaines caractéristiques mammaires (seins tubulaires, asymétriques, intervalle important entre les 2 seins…). L’hypogalactie induira une stagnation pondérale chez le nourrisson, avec baisse du volume des urines et risque de déshydratation en dépit d’une succion efficace chez le nourrisson.