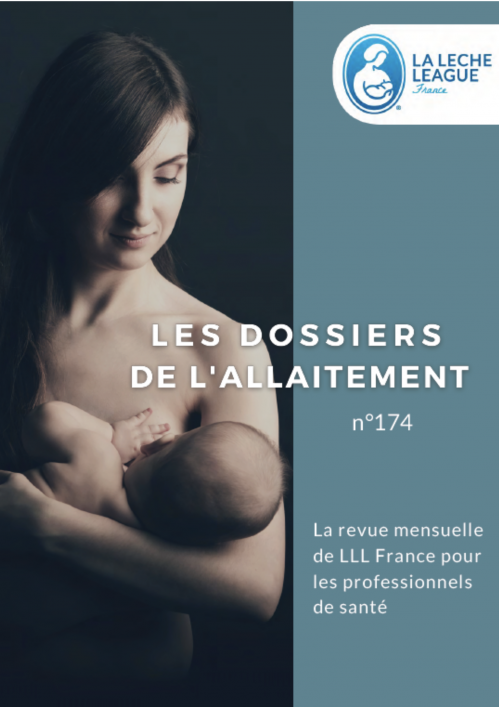Mieux comprendre la transmission verticale du VIH : le cas d’une mère kenyane
On estimait qu’en 2022, environ 1,2 million de femmes enceintes étaient séropositives pour le VIH. En l’absence de mesures, le taux de transmission verticale du VIH pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement était de 15 à 30 %. Ce taux est < 2 % chez les femmes traitées par antirétroviraux. Malgré cela, on estime qu’en 2022, environ 130 000 enfants ont été contaminés. Environ 80 % des femmes séropositives pour le VIH dans le monde sont traitées par antirétroviraux. Au Kenya, on estime que 890 000 femmes sont séropositives. Ce pays est l’un de ceux qui se sont engagés à faire de gros efforts pour limiter la transmission verticale du VIH, et 91 % des femmes enceintes séropositives étaient traitées par antirétroviraux en 2021. Malgré cela, le taux de transmission verticale est de 8,9 %, et on estime qu’environ 5 200 enfants ont été contaminés en 2021. L’efficacité du traitement antirétroviral dépend du moment où il est débuté, du niveau maternel de suivi du traitement, des difficultés du suivi de ces femmes, des difficultés à suivre les recommandations en matière d’alimentation infantile… Pour mieux comprendre les raisons des contaminations infantiles dans ce contexte, les auteurs présentent un cas de mère séropositive pour le VIH dont le bébé a été testé positif pour le VIH à 4 semaines post-partum, la dyade étant suivie dans le cadre d’une étude interventionnelle destinée à limiter l’insécurité alimentaire et à optimiser l’alimentation infantile.
Acidocétose sévère chez une mère allaitante sous régime cétogène
L’acidocétose lactationnelle est un problème relativement rare induit par la conjonction entre l’augmentation des dépenses métaboliques liées à la lactation et la baisse des apports glucidiques de la mère. Le régime cétogène est devenu populaire chez les femmes en post-partum en raison de la perte de poids rapide qu’il induit. Ce régime se caractérise par des apports glucidiques très bas, ce qui est susceptible de présenter des risques pour certaines personnes, incluant les mères allaitantes. Les auteurs présentent le cas d’une femme qui a présenté une acidocétose sévère suite à la mise en oeuvre par la mère (sans indication médicale spécifique) d’un régime cétogène.
Vécu d’une mère qui a donné son lait après le décès de ses bébés
Le taux de mortalité néonatale au Vietnam en 2020 était inférieur à 1 % des naissances vivantes. S’il a significativement baissé au fil des années, il reste nécessaire de soutenir les parents concernés dans leur deuil. Ce soutien est particulièrement important pour la mère dans la mesure où elle devra gérer sa lactation. Le nombre de lactariums dans le monde a augmenté depuis une vingtaine d’années, et le don de lait humain est de plus en plus recommandé chez les prématurés et les nourrissons malades. Actuellement, de plus en plus de mères qui ont perdu leur bébé souhaitent donner leur lait à un lactarium pendant plus ou moins longtemps lorsqu’on leur propose cette possibilité. Toutefois, les mères reçoivent rarement des informations sur la gestion de leur lactation après le décès de leur bébé. Pourtant, des études ont constaté que cela pouvait aider la mère à faire son deuil, et que de nombreuses mères appréciaient de savoir que leur lait pouvait aider d’autres bébés. Les auteurs de cette présentation ont suivi une mère qui, après le décès de ses jumeaux, a décidé de donner son lait au 1er lactarium ouvert au Vietnam.
Carence maternelle partielle en N-acétylglutamate synthase ayant induit une hyperammoniémie en post-partum
Le cycle de l’urée transforme l’ammoniac en urée qui sera excrétée dans les urines. Les personnes présentant un trouble du cycle de l’urée pourront présenter une augmentation importante de leur ammoniémie, ce qui induira des séquelles neurologiques potentiellement désastreuses. Une des étapes de ce cycle nécessite une enzyme, la carbamyl phosphate synthétase-1 (CPS-1), qui fonctionne avec une co-enzyme, la N-acétylglutamate synthase (NAG). La carence en NAG est l’une des plus rares parmi les carences qui peuvent concerner le cycle de l’urée. Elle induit une hyperammoniémie, avec vomissements, léthargie, désorientation, ataxie et intolérance alimentaire. Sa sévérité est variable en fonction de la variation en cause du gène codant pour la NAG. Les manifestations cliniques débutent tôt dans la vie dans les formes sévères, mais les formes partielles peuvent se manifester plus tardivement. Cette carence est traitée par la prise d’acide carglumique, un analogue de la NAG. Les auteurs présentent le cas d’une femme qui présentait 2 nouvelles variations du gène de la NAG, qui a présenté une hyperammoniémie en post-partum, et qui a été incluse, ainsi que ses parents, dans une étude clinique observationnelle sur ce type de carence avec bilans exhaustifs.